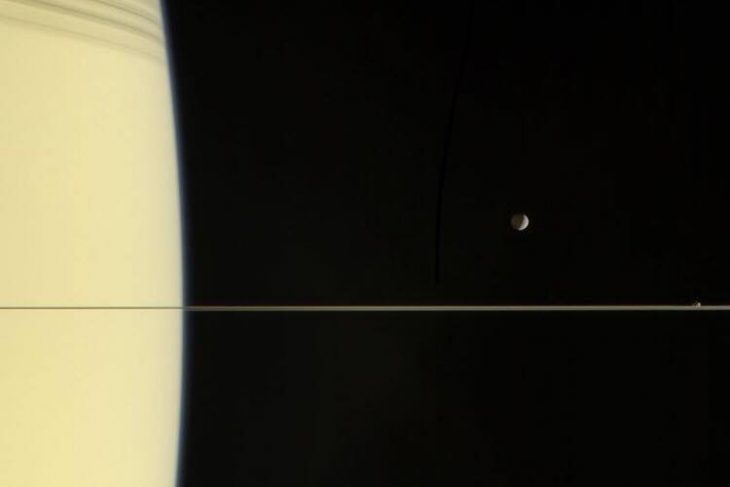Explorer l’univers offre maintes occasions de flirter avec l’infini, que ce soit dans les distances mises en jeu ou dans les endroits où règnent des conditions extrêmes, comme les trous noirs. Dans les deux cas, le télescope spatial James-Webb (JWST), offre une aide précieuse pour y voir plus clair. L’équipe de Farhad Yusef-Zadeh, de l’université Northwestern, à Evanston, aux États-Unis, a pu pointer l’œil du JWST vers Sagittarius A*, le trou noir supermassif (4,3 millions de masses solaires) qui se terre au cœur de notre galaxie. Et ils ont fait une découverte surprenante.
L’instrument NIRcam, une caméra sensible à deux longueurs d’onde distinctes dans le proche infrarouge, est resté pointé vers le centre de la Voie lactée pendant une période cumulée de deux jours (par série d’une dizaine d’heures réparties sur une année). Avec une telle exposition, les astrophysiciens s’attendaient bien à repérer quelques éruptions lumineuses émanant du disque d’accrétion, lorsque la matière de cet objet (poussières et gaz) s’approche de l’horizon des événements du trou noir. Ce qu’ils ont vu est allé bien au-delà de leurs espérances.
En effet, ils ont observé un « feu d’artifice » constitué d’émissions variables en intensité et en durée : sans aucune périodicité apparente à ce jour, certaines semblent, selon des estimations faites à partir des observations, très longues et fortes, d’autres restent courtes (quelques secondes) et peu énergétiques, comme des petits scintillements. Comment expliquer ces deux phénomènes ?
Selon les auteurs de l’étude, les premières résulteraient de collisions de deux champs magnétiques libérant des particules relativistes. Les plus brèves trahiraient quant à elles des fluctuations dans le plasma qui enveloppe le disque d’accrétion.
Autre surprise, les événements observés à la plus petite des deux longueurs d’onde de NIRcam changeaient de luminosité légèrement avant ceux regardés à la plus grande longueur d’onde. Ce serait le signe d’une perte d’énergie des particules durant l’éruption plus rapide aux courtes longueurs d’onde qu’aux grandes.
Ensemble, ces résultats inattendus donnent du grain à moudre aux théoriciens chargés d’élucider le comportement de ces trous noirs supermassifs, leur évolution, leur dynamique et leurs interactions avec l’environnement. Autre question : le comportement particulièrement instable de Sagittarius A* semble lui être propre. Pourquoi les autres trous noirs supermassifs ne sont-ils pas aussi chahutés ?
Auteur : Loïc Mangin
Aller à la source