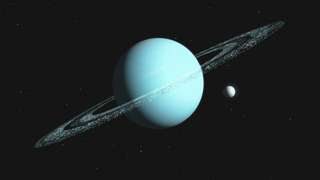Plus précis, le télescope James Webb, en orbite depuis 2021, permet d’analyser le composé des sols des exoplanètes. Des données précieuses et inédites qui révèlent pour l’instant des milieux hostiles à la vie.
![]()
Publié
Temps de lecture : 2min

En dehors de notre système solaire, tournent d’autres planètes, les exoplanètes, qui sont donc lointaines et souvent difficiles à observer. Mais les avancées en la matière ont permis de développer des télescopes plus précis et plus puissants afin de voir à quoi le sol de ces exoplanètes ressemble.
Voilà 30 ans que l’on détecte ces exoplanètes qu’on estime être plusieurs milliards, mais que l’on connaît au nombre d’environ 6 000. Désormais, il est possible de voir à quoi ressemblent les plus petites, et notamment les rocheuses, qui sont similaires à la Terre. Une véritable prouesse technologique qui permet de décrire des étendues de roches basaltiques, des terres volcaniques et des sols recouverts de poussière minérale ou de régolite, semblable à la Lune, par exemple.
Il a fallu attendre l’arrivée du télescope spatial James Webb, envoyé en orbite en 2021. C’est le plus gros télescope envoyé dans l’espace jusqu’à maintenant. Il observe ces planètes par infrarouge, ce qui permet de capter la faible lumière qu’elles émettent. C’est à partir des caractéristiques de cette lumière que l’on peut déduire quelles roches et quelles surfaces recouvrent ces planètes. Le rendu n’est pas visuel, ce ne sont pas des photos, mais plutôt des analyses traitées en point sur des courbes. En les comparant avec les analyses en laboratoire, sur des roches terrestres ou des roches d’astéroïdes, on peut alors en déduire la composition.
À 40 années-lumière de notre planète bleue, la planète Trappist 1b, la plus proche d’une petite étoile orange, qui compte 7 planètes rocheuses, a été particulièrement étudiée. D’après les données récoltées, elle n’aurait pas d’atmosphère et son sol serait composé de roches basaltiques riches en olivines comme on en trouve dans le manteau terrestre. On peut donc s’imaginer une étendue grise, assez austère. La planète LHS 3844 b, un peu plus loin, à presque 50 années-lumière de la Terre, serait, elle, couverte de régolite, mais n’aurait pas non plus d’atmosphère. Des planètes peu hospitalières donc, sans eau, ni argile, mais seulement de roches.
Auteur :
Aller à la source