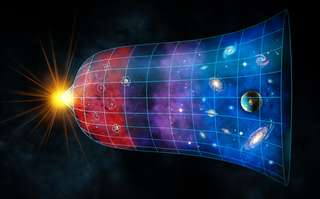Il y a encore une dizaine d’années, l’humanité lançait environ 200 objets dans l’espace par an. Aujourd’hui, nous en lançons plus de 2 600, sans aucune perspective de ralentissement. Cette expansion rapide de l’activité humaine dans l’espace a truffé l’orbite terrestre de déchets spatiaux, qu’il s’agisse de satellites hors service ou de pièces de fusées usagées. L’espace proche est déjà si encombré que les satellites en activité courent le risque d’entrer en collision avec des débris provenant des générations précédentes d’engins spatiaux. Même la Station spatiale internationale doit régulièrement ajuster son orbite pour éviter de heurter des fragments dangereux.
À l’heure actuelle, on dénombre plus de 25 000 débris d’origine humaine de plus de 10 centimètres en orbite autour de la Terre. Et plus ceux-ci sont nombreux, plus il est probable que certains (qui voyagent à une vitesse relative jusqu’à 15 fois supérieure à celle d’une balle de fusil) heurtent des engins spatiaux en activité, créant ainsi d’autant plus de débris menaçants. La collision catastrophique survenue en 2009 entre le satellite russe Cosmos 2251, hors d’usage, et le satellite américain Iridium 33, a par exemple produit près de 2 000 fragments, dont beaucoup sont encore surveillés aujourd’hui.
L’orbite proche est une ressource limitée, qu’une poignée d’organisations, notamment SpaceX, OneWeb et le projet Kuiper d’Amazon, consomment de manière croissante. SpaceX, en particulier, possède et exploite la majorité de tous les satellites en service, et la société a pour objectif de lancer des dizaines de milliers d’autres satellites afin de fournir une couverture internet à large bande à l’échelle mondiale. De même, Amazon prévoit de déployer 3 236 satellites pour son réseau à large bande. Si nous continuons à ce rythme, l’orbite terrestre deviendra inutilisable, en particulier la région la plus recherchée, l’orbite terrestre basse (LEO), qui s’étend jusqu’à 2 000 kilomètres d’altitude. Si l’on considère l’ensemble des orbites exploitables, nous risquons de mettre en péril des services dont nous sommes devenus dépendants : communications en temps réel, cartographie GPS, internet, surveillance de la Terre, etc. Actuellement, presque chaque satellite lancé équivaut à positionner dans l’espace un morceau de plastique à usage unique, dans la mesure où son destin final n’est envisagé sous nulle autre forme que de devenir… un déchet. Nous nous dirigeons vers une tragédie des biens communs en milieu orbital. Offrir à tous un accès illimité à ce milieu, sans coordination ni planification à l’échelle mondiale, signifie qu’à terme, personne ne sera plus en mesure d’en profiter.

© Jen Christiansen ; source : Satellite statistics : satellite and debris population, Jonathan’s Space Report
Usage unique
Alors que nous continuons à repousser les limites de l’exploration et de la commercialisation de l’espace, un mouvement se dessine pour repenser notre approche de l’utilisation de l’environnement spatial et nous orienter vers une stratégie ancrée dans des principes d’intendance et de gestion rationnelle des débris. Je pense que nous devons laisser de côté notre « économie spatiale linéaire », dans le cadre de laquelle nous tirons parti puis abandonnons satellites et vaisseaux, au profit d’une « économie spatiale circulaire », qui mettra l’accent sur la réutilisation, le recyclage et la gestion efficace des ressources spatiales.
Tout comme nous nous interrogeons sur la meilleure manière de prendre soin des écosystèmes de la Terre pour les êtres vivants à l’avenir, nous devons considérer l’espace comme un environnement digne d’être durablement préservé. D’autant qu’une telle réforme de notre exploitation de l’espace est essentielle pour la protection de notre environnement sur Terre. En effet, la production, le lancement et le fonctionnement des satellites et des fusées consomment de grandes quantités de ressources et d’énergie, contribuant ainsi aux émissions de gaz à effet de serre et à la dégradation de l’environnement. Les lancements de fusées libèrent des polluants, notamment du dioxyde de carbone, de la suie et des oxydes d’aluminium, qui endommagent l’atmosphère et contribuent au changement climatique. En outre, la pratique des rentrées incontrôlées, qui consiste à laisser des satellites et des étages de fusée hors d’usage se consumer dans l’atmosphère, aggrave la pollution atmosphérique et crée un risque de chute de débris sur les personnes et les biens sur Terre. En 2024, par exemple, des morceaux d’un module de service Dragon de SpaceX, dont un de la taille d’un capot de voiture, ont atterri dans les montagnes de Caroline du Nord ; et un fragment issu de la Station spatiale internationale a traversé le toit d’une maison à Naples, en Floride.
Le paradigme d’économie spatiale circulaire fait référence aux principes de conception des produits et de gestion de leur fin de vie qui intègrent d’emblée leur réutilisation ou leur recyclage. La première étape consiste à concevoir des engins spatiaux avec des matériaux qui minimisent la pollution et engendrent moins de déchets. La deuxième, à réparer les composants endommagés des satellites en orbite pour prolonger leur cycle de vie. La troisième est de recycler les matériaux des satellites hors d’usage pour s’en servir lors de nouvelles missions, sans avoir à ramener les satellites sur Terre. Enfin, nous devons recueillir et retraiter les débris spatiaux afin de réduire les risques de collision et récupérer leurs composants valorisables.
Services en orbite
Une telle approche implique certaines innovations technologiques. Nous ne disposons pas actuellement de techniques permettant d’entretenir tous les engins spatiaux en orbite, même si plusieurs entreprises et agences spatiales y travaillent. Nous devons développer des technologies à même d’allonger la durée de vie opérationnelle des satellites et de limiter les missions de remplacement coûteuses et gourmandes en ressources. Nous avons besoin d’engins spatiaux capables de s’approcher des satellites vieillissants et de s’y amarrer, associés à des robots pour les réparer, les ravitailler et les mettre à niveau. Nous aurons également besoin de dispositifs à même de recycler tout ou partie des satellites au terme de leur service.
Actuellement, tous les satellites deviennent des épaves lorsque leur mission principale prend fin, et les nouveaux sont construits à partir de matériaux entièrement neufs. C’est un gâchis considérable, à l’instar de nos casses pour les voitures et autres véhicules au rebut. La technologie des fusées réutilisables que SpaceX continue à faire progresser constitue une étape positive pour y remédier. Les boosters de ses fusées Falcon 9, par exemple, sont capables d’atterrir verticalement après avoir été largués dans l’espace, et de voler à nouveau, après une étape de remise à niveau. Cela permet d’économiser de l’argent (le recyclage des boosters réduit le coût de chaque lancement de Falcon 9 jusqu’à 30 %) et de produire moins de déchets. Mais jusqu’à présent, SpaceX est la seule entreprise ou agence à lancer des satellites à l’aide de fusées réutilisables. Il en faudra davantage.
L’entretien des satellites en orbite fait aussi l’objet de progrès. SpaceLogistics (filiale de Northrop Grumman) a mis au point un vaisseau spatial, le MEV (Mission Extension Vehicle), pour aider les satellites vieillissants à poursuivre leur activité. En 2020, il s’est amarré avec succès au satellite Intelsat 901, à court de carburant, et a utilisé ses propres propulseurs et son propre carburant pour manœuvrer l’ensemble formé, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle du satellite. Un deuxième MEV s’est amarré à un autre satellite Intelsat en 2021. Lorsque ces satellites seront prêts à être retirés du service, les MEV se désamarreront, libres de se diriger vers d’autres engins spatiaux. Le lancement d’un MEV pour aider un vaisseau en difficulté coûte, environ, de la moitié au quart du prix de la construction et du lancement d’un satellite neuf. Outre les économies réalisées, l’entretien en orbite réduit la fréquence des lancements de nouveaux satellites, ce qui minimise l’accumulation de débris spatiaux et les émissions de gaz à effet de serre qui accompagnent les lancements de fusées.
Désorbitation
Retirer les débris en orbite est un autre défi. Selon leur type, cela requiert des techniques d’enlèvement variées, dont beaucoup sont inspirées de l’industrie de la pêche : certaines stratégies recourent à des filets, d’autres à des harpons, d’autres encore à des hameçons. Chaque approche a ses limites et ne fonctionne que pour un sous-ensemble des objets qui doivent être enlevés de l’espace orbital. Il est également très coûteux de récupérer les déchets spatiaux, quels qu’ils soient, car tout ce qui n’est pas activement contrôlé dans l’espace est en rotation aléatoire. Cela signifie que pour saisir un objet et l’extraire, il faut soit trouver un moyen de le stabiliser, soit faire en sorte que le satellite chargé de l’évacuation des débris épouse son mouvement. Cela nécessite beaucoup d’énergie, ce qui entraîne des coûts élevés en ergols.
Néanmoins, des progrès ont été réalisés. En 2021, une société basée à Tokyo, Astroscale, a conduit la démonstration End-of-Life Services by Astroscale (ELSA-d), qui a lancé deux satellites : l’un jouant le rôle d’un vaisseau inerte et l’autre celui de vaisseau assistant. Les deux engins se sont arrimés avec succès en orbite, puis se sont libérés, testant ainsi un processus essentiel pour l’élimination éventuelle des débris. L’entreprise a effectué d’autres tests en 2024 dans le cadre de sa mission ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan), réussissant à maintenir une distance réduite (15 mètres) entre un satellite d’assistance et un étage de fusée hors service.
L’Agence spatiale européenne (ESA), en partenariat avec la start-up ClearSpace, devrait lancer sa mission ClearSpace-1 en 2028. ClearSpace-1 utilisera quatre bras robotiques pour s’accrocher au satellite PROBA-1 de l’agence et l’extraire de son orbite. Le projet ambitionne de développer la capacité de cibler des objets complexes et de taille importante.

© ClearSpace SA
Enfin, une technologie de propulsion plus efficace est requise pour que les engins spatiaux consomment moins de carburant et mènent des missions plus longues avec leur seule charge initiale. Les récents développements des systèmes de propulsion électrique, tels que les propulseurs ioniques et à effet Hall, offrent une plus grande efficacité que la propulsion chimique traditionnelle. Ils exploitent l’énergie électrique pour ioniser le propergol et engendrer ainsi de la poussée, ce qui permet aux véhicules spatiaux et sondes d’atteindre des vitesses plus élevées et d’effectuer des manœuvres précises sur de longues périodes. La propulsion électrique équipe déjà de nombreux satellites opérationnels et deviendra de plus en plus courante.
Les nouvelles technologies seules ne suffiront pas à résoudre le problème des débris spatiaux, une évolution du contexte juridique est également nécessaire. La politique spatiale mondiale actuelle est un patchwork de réglementations fragmentées, souvent en retard sur les avancées technologiques et les besoins évolutifs des activités spatiales, et qui entrave les collaborations internationales. SpaceX, par exemple, a dû faire face à des difficultés réglementaires pour déployer ses fusées réutilisables, parce que les lois en vigueur n’envisageaient pas ce type de technologie.
Gestion durable
L’Union européenne tente d’ouvrir la voie en intégrant les principes de durabilité dans ses politiques spatiales. Elle a rationalisé les procédures d’octroi de licences pour les lancements de satellites et les opérations en orbite dans tous les États membres – ce sur quoi les États-Unis ont également commencé à travailler – et a alloué des fonds importants à la recherche et au développement sur la gestion des débris spatiaux. Mais la plupart des pays en sont encore loin.
Les gouvernements ont un rôle important à jouer pour inciter les entreprises à concevoir et à développer des systèmes spatiaux durables. L’un des moyens d’y parvenir serait d’adopter ce que l’on appelle des « lois sur la responsabilité élargie des producteurs », qui obligent les entreprises à contribuer à la gestion des déchets issus de ce qu’elles produisent. Les gouvernements pourraient aussi, éventuellement, avoir recours à un système d’allocations de quotas pour réguler la quantité de débris spatiaux que l’industrie est autorisée à créer.
Les lois pourraient également encourager la conception, le lancement et l’exploitation de centres de recyclage en orbite où les satellites vieillissants et hors d’usage pourraient être réutilisés.
En fin de compte, les gouvernements qui autorisent le lancement de vaisseaux spatiaux sont responsables des dommages que ces engins peuvent causer. Cependant, aucun d’entre eux, y compris la Russie, les États-Unis ou la Chine, ne met en place des structures de marché pour les services de ramassage et d’enlèvement des déchets spatiaux. En outre, il n’existe actuellement aucun mécanisme juridique permettant de transférer la responsabilité des dommages d’un « État de lancement » à un autre. Cela complique la mise en place d’une loi sur le sauvetage dans l’espace, analogue à celle qui existe dans la gestion internationale des risques liés aux activités maritimes.
Le Comité des Nations unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique joue, certes, un rôle essentiel dans le développement du droit et des normes spatiales internationales. Ses recommandations sur la réduction des débris spatiaux encouragent les États membres à bien les gérer et à promouvoir des opérations spatiales durables. Plus de 100 pays ont approuvé ces lignes directrices, qui n’ont cependant pas valeur de lois.
L’exploration spatiale soulève également des questions éthiques fondamentales relatives à l’extraction équitable des ressources, la propriété et la gestion de l’environnement. L’exploitation minière des astéroïdes, par exemple, offre la possibilité d’accéder à des ressources rares. Mais elle risque également d’affecter le potentiel de découverte scientifique et le patrimoine culturel éventuellement lié à ces corps célestes. De plus, l’exploitation minière de l’espace pourrait déstabiliser les marchés mondiaux – imaginez l’exploitation d’un astéroïde gorgé de platine. En outre, qui devrait être autorisé à profiter des ressources des astéroïdes ? Est-il juste que seuls certains pays, ou certains milliardaires, s’enrichissent et deviennent encore plus puissants grâce aux produits de l’espace ?
Des organisations telles que l’Institut international du droit de l’espace et le Bureau des affaires spatiales des Nations unies tentent d’élaborer des prescriptions éthiques pour une exploitation responsable des ressources spatiales, en mettant l’accent sur la transparence, la coopération internationale et la durabilité. Des initiatives telles que le Space Sustainability Rating, qui vise à certifier les missions spatiales sur la base de pratiques durables, pourraient encourager les entreprises et les nations à agir de manière responsable.
Préserver l’environnement spatial pour les générations futures est un impératif moral. La mise en place d’une économie spatiale circulaire n’est pas une option, mais une nécessité pour l’avenir durable de l’exploration spatiale. Nous pouvons réduire les risques de collision avec des débris, préserver les ressources et faire en sorte que l’espace extra-atmosphérique reste un domaine viable pour la découverte scientifique et l’innovation commerciale. Les décideurs politiques, les chefs d’entreprise, les scientifiques et la communauté internationale doivent adopter une approche durable de nos activités en orbite terrestre, afin d’en préserver le potentiel pour les générations à venir.