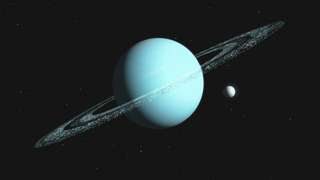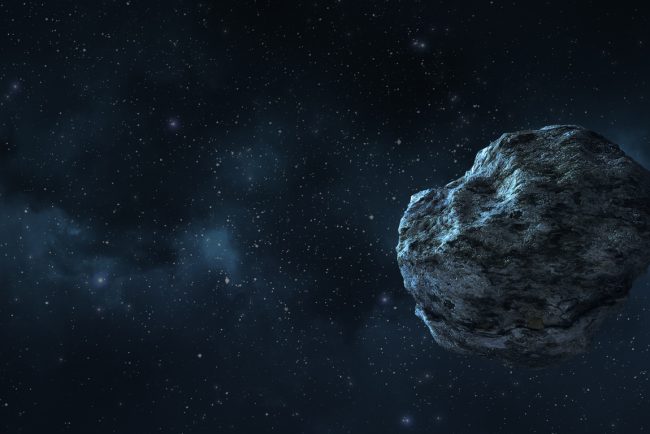Depuis plus d’une décennie, le rover Curiosity explore la planète Mars en quête d’indices sur son passé. Son objectif principal ? Déterminer si la planète rouge a un jour été propice à la vie. Récemment, une découverte majeure vient relancer le débat : les plus grosses molécules organiques jamais détectées sur Mars ont été trouvées dans des roches vieilles de 3,7 milliards d’années. Une avancée qui, sans prouver l’existence d’une vie passée, confirme que les conditions chimiques nécessaires à son apparition étaient bien présentes.
Les molécules organiques : des indices précieux mais non concluants
Lorsque l’on parle de molécules organiques, on pense souvent immédiatement à la vie. Pourtant, en chimie, ce terme désigne simplement des molécules contenant du carbone, un élément capable de s’associer à de nombreux autres atomes pour former des structures complexes. Sur Terre, ces molécules sont omniprésentes et constituent la base du vivant. Mais elles peuvent également se former sans intervention biologique, par des processus purement chimiques.
Ainsi, la découverte de ces molécules organiques sur Mars ne signifie pas forcément que la planète a hébergé la vie. En revanche, elle prouve que si la vie a existé dans le passé, certains de ses résidus chimiques pourraient avoir été préservés dans les roches martiennes.
Une découverte réalisée dans une ancienne argile
C’est dans une zone appelée Cumberland, située dans le cratère Gale, que Curiosity a prélevé un échantillon de mudstone (une roche sédimentaire argileuse). Cette région est particulièrement intéressante car elle contient des dépôts d’argile datant d’une époque où Mars possédait encore de l’eau liquide en surface.
Grâce à son instrument SAM (Sample Analysis at Mars), le rover a chauffé l’échantillon à différentes températures pour analyser les composés libérés. Les scientifiques ont ainsi détecté des molécules carbonées bien plus complexes que celles découvertes auparavant, notamment des alcanes comme le décane (C10H22), l’undécane (C11H24) et le dodécane (C12H26). Ces longues chaînes de carbone sont particulièrement intéressantes, car elles peuvent être issues d’acides gras, des composants essentiels des membranes cellulaires sur Terre.

Pourquoi est-ce une découverte majeure ?
Jusqu’à présent, Curiosity n’avait détecté que des molécules contenant au maximum six atomes de carbone. La détection de chaînes plus longues indique que des structures organiques plus complexes ont pu exister sur Mars, et qu’elles ont pu être préservées dans certaines roches pendant des milliards d’années.
Sur Terre, des acides gras similaires peuvent être produits par des processus chimiques naturels. Mais les plus longues chaînes, comme les acides oléiques (C16, C18), sont généralement considérées comme des marqueurs plus probables de la vie. Or, si ces molécules avaient été présentes sur Mars, elles auraient pu être dégradées par le processus de chauffage utilisé par SAM, ce qui signifie que nous pourrions être passés à côté d’indices encore plus significatifs.
Une planète hostile, mais des traces chimiques persistantes
Mars est aujourd’hui une planète aride et hostile. Son atmosphère ténue et son absence de champ magnétique exposent sa surface à un bombardement constant de radiations cosmiques, un environnement peu propice à la préservation des molécules organiques. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, certaines molécules semblent avoir été préservées pendant des milliards d’années, cachées dans des couches rocheuses profondes.
Cette résistance des molécules organiques est une bonne nouvelle pour les futures missions d’exploration. Si Mars a abrité la vie dans le passé, il y a une réelle possibilité que ses traces chimiques soient encore détectables aujourd’hui, pour peu que l’on utilise des instruments suffisamment puissants.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Même si cette découverte est une avancée majeure, elle ne permet pas d’affirmer que Mars a été le berceau d’une vie ancienne. Pour lever ce doute, plusieurs stratégies sont envisagées.
La première option serait d’envoyer un rover plus avancé. Curiosity a permis d’identifier des molécules organiques complexes, mais il ne dispose pas des outils nécessaires pour en analyser la structure détaillée. Un rover équipé d’instruments plus performants, capables de détecter des biosignatures plus précises, pourrait fournir des résultats plus concluants.
Une autre approche serait de rapporter des échantillons sur Terre. La mission Mars Sample Return, en cours de développement, prévoit de récupérer les échantillons prélevés par le rover Perseverance pour les analyser avec des laboratoires terrestres bien plus sophistiqués que ceux embarqués sur un robot martien. Cette mission, bien que freinée par des problèmes essentiellement budgétaires, offrirait une opportunité unique d’étudier ces matériaux avec une précision inégalée.
Enfin, il serait pertinent d’explorer d’autres régions martiennes. Certaines zones, comme d’anciens lits de rivières ou cratères, pourraient en effet contenir des fossiles chimiques encore mieux préservés que ceux découverts dans le cratère Gale. En élargissant les sites d’exploration, les scientifiques maximiseraient leurs chances de trouver des preuves plus directes d’une éventuelle vie passée sur la planète rouge.