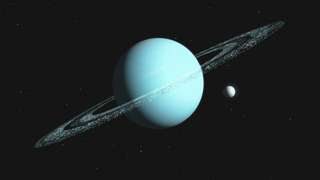L’astéroïde 2024 YR4, découvert en décembre dernier, a suscité l’inquiétude dans le monde entier après que des chercheurs ont annoncé, mardi 18 février, que la probabilité qu’il entre en collision avec la Terre fin 2032 atteignait 3,1 % – un record. De nouvelles observations ont depuis conduit la Nasa à réévaluer ce risque à 1,5 %. Cela reste néanmoins élevé pour un astéroïde de 40 à 100 mètres de diamètre – une taille suffisante pour rayer une ville de la carte –, ce qui justifie que des observations poussées se poursuivent afin de préciser sa trajectoire.
« Une probabilité d’impact de 3,1 % était la plus élevée jamais observée pour un astéroïde de cette taille ou plus », précise Davide Farnocchia, du Centre d’études des objets géocroiseurs (Center for near earth object studies) de la NASA (à l’origine de la première estimation). Selon lui, cette probabilité va sans doute évoluer encore à la baisse dans les prochaines semaines.
Repéré pour la première fois par un télescope au Chili dédié à la surveillance des astéroïdes le 27 décembre dernier, 2024 YR4 n’a fait parler de lui qu’un mois plus tard, lorsque les premières estimations de son orbite ont révélé que cet objet avait plus de 1 % de chances d’entrer en collision avec la Terre le 22 décembre 2032. Le couloir de risque d’impact s’étend de l’est de l’océan Pacifique à l’Asie du Sud en passant par le nord de l’Amérique du Sud, l’Afrique subsaharienne et l’Inde, incluant des grands centres urbains comme Bogota en Colombie, Lagos au Nigéria et Mumbai en Inde. Il existe même un risque de 0,8 % que l’astéroïde percute la Lune.
En cas de collision, que 2024 YR4 explose dans l’atmosphère ou creuse un cratère à la surface, l’énergie libérée serait équivalente à celle d’une bombe de 10 mégatonnes, soit environ 1 000 fois la bombe atomique de Hiroshima. De quoi pulvériser toute métropole malchanceuse qui se trouverait sur sa trajectoire.
Il n’est donc pas étonnant que les réévaluations successives à la hausse du risque d’impact de l’astéroïde 2024 YR4 aient préoccupé les astronomes et le public. Pourquoi les estimations du risque de collision avec ce bolide spatial sont-elles aussi fluctuantes ? Pourquoi les astronomes ne semblent-ils pas plus inquiets que cela de la probabilité croissante qu’il percute notre planète ? Et pourquoi cela prend-il autant de temps pour discerner si un astéroïde représente un danger ?
La réponse tient en un mot : plus on veut déterminer l’orbite d’un objet de façon précise et fiable, plus il faut l’observer longtemps. Et les astronomes n’ont pas encore beaucoup de temps pour observer l’astéroïde 2024 YR4, découvert il y a moins de deux mois. D’autant qu’il s’éloigne maintenant de nous et est déjà trop faible dans le ciel pour que la plupart des télescopes puissent l’observer. Mais il reste surveillé de façon régulière par plusieurs grands observatoires, et le télescope spatial James Webb sera mobilisé début mars, puis début mai pour affiner les estimations de la taille et de la trajectoire de 2024 YR4 juste avant qu’il ne disparaisse de notre champ de vision (jusqu’à ce que son orbite le ramène à proximité de la Terre en 2028).
La relative rareté des données explique la fluctuation du risque d’impact estimé (qui, avant de culminer à 3,1 %, était monté à plus de 2 % début février). Selon Davide Farnocchia, cette augmentation est due à deux facteurs : une absence totale d’observations pendant environ une semaine à cause de la pleine Lune de février, suivie d’un afflux de nouvelles données provenant de deux observatoires (l’observatoire de Magdalena Ridge au Nouveau-Mexique, et le télescope optique nordique de La Palma, dans les îles Canaries), qui ont repris leur suivi le 15 février. Le traitement indépendant de toutes ces données est effectué dans trois installations distinctes : Le Centre d’étude des objets géocroiseurs de la NASA, en Californie, ainsi que le Centre de coordination des objets géocroiseurs de l’Agence spatiale européenne (ESA, basé en Italie, et le service NEODys (Near Earth Objects Dynamic Site) géré pour l’ESA par la société SpaceDyS, à Pise. Jusqu’à présent, les trois centres sont parvenus aux mêmes conclusions générales.

L’astéroïde géocroiseur 2024 YR4, vu par le Very Large Telescope européen en janvier 2025, peu après sa découverte.
© ESO/O. Hainaut et al. (CC BY 4.0)
« Pour l’instant, je ne suis pas inquiet », déclare Detlef Koschny, planétologue à l’université technique de Munich, qui, au nom de l’ESA, préside le Groupe consultatif pour la planification des missions spatiales (SMPAG), une organisation affiliée aux Nations unies chargée de coordonner les réponses mondiales aux menaces posées par les astéroïdes. C’est un peu contre-intuitif, mais « à mesure que l’incertitude diminue, la proportion des trajectoires passant par la Terre parmi les trajectoires possibles augmente… jusqu’à ce que, probablement, le faisceau de trajectoires possibles finisse par ne plus du tout croiser notre planète ». Imaginez un stand de tir à la carabine. Si on estime la trajectoire de la balle à la sortie du canon, on peut prévoir qu’elle atteindra n’importe quelle partie de la cible. Mais à mesure que le projectile s’approche de la cible, l’estimation peut être plus précise et indiquer que la balle touchera une région vers le centre de la cible. Le rond central (la Terre) occupera alors une plus grande surface de cette région plus petite, et la probabilité qu’il soit touché augmentera, même si la balle termine en réalité hors du rond central.

Les emplacements possibles de l’astéroïde 2024 YR4 le 22 décembre 2032, selon les données disponibles le 19 février 2025. La Terre est proche du centre du cercle blanc, qui représente la trajectoire de la Lune.
© NASA JPL/CNEOS
C’est ce qui s’est passé avec l’astéroïde géocroiseur Apophis. Après sa découverte en 2004, les projections indiquaient une collision possible avec la Terre en 2029. Dans les mois qui ont suivi, la probabilité a grimpé jusqu’à 2,7 % – le précédent record – avant de retomber à 0 % après des observations supplémentaires.
Selon toute vraisemblance, l’augmentation de la probabilité d’impact de 2024 YR4 dans les mois à venir s’avérera être une fausse alerte similaire (c’est peut-être la raison pour laquelle les astronomes ont jusqu’à présent obstinément refusé de lui donner un nom plus accrocheur). En attendant, le plus sage est sans doute d’ignorer les fluctuations de l’estimation du risque d’impact.
En réalité, l’orbite de 2024 YR4 est déjà suffisamment certaine pour que « personne ne réagisse vraiment aux variations quotidiennes des estimations », explique Timothy Spahr, qui travaille pour le Réseau international d’alerte aux astéroïdes (International Asteroid Warning Network). « Oui, la probabilité d’impact peut changer, mais pour être plus précis que « quelques pour cent », nous devrons augmenter l’arc d’observation de plus de 30 jours ». Cela peut sembler un « peu fastidieux », admet-il. Mais d’ici à ce que l’astéroïde 2024 YR4 échappe à nos regards dans le courant de l’année, les astronomes devraient en savoir beaucoup plus sur le danger qu’il représente réellement.
Néanmoins, si les estimations du risque d’impact de 2024 YR4 restaient inquiétantes d’ici là, et a fortiori lors de son prochain passage en 2028, des mesures préventives pourraient être prises pour 2032. Cela pourrait aller de l’évacuation des zones situées dans le couloir de risque au lancement de missions spatiales visant à dévier la trajectoire de l’astéroïde où à le faire exploser. Mais « étant donné que les observations à venir sont susceptibles d’exclure la possibilité d’un impact, conclut Davide Farnocchia, il est prématuré d’envisager sérieusement de dévier l’astéroïde 2024 YR4 ».